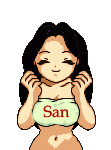Les terres des Cendres étaient terres de malédiction. La vie n'y avait que la valeur d'un instant. Mais on y vivait et retranchés derrière leurs fortifications les humains cherchaient à panser ces plaies démoniaques d'un autre temps.
Au nord des Cendres, entre montagnes et forêts le village d'Arcelon étendait palissades, fosses et filets, et imitait les cités dans ce recoin bestial. Des petites troupes de chaumières s'accrochaient aux pentes du val et étendaient des chemins de terre, des petits jardins, quelques enclos de bêtes et partout boucliers, blasons et brassées d'armes sous les foyers estivals. Le jour passait aux bruits du fer, aux chutes d'arbres, aux coups de la forge et aux cris guerriers sur la caillasse.
La nuit était emplie de râles.
La nuit le village n'existait plus que par ces dernières lueurs de foyers derrière les volets, quelque lanterne fugace et le reflet du ciel sur le métal. Les râles douloureux se mêlaient aux appels des bêtes. À l'heure la plus noire le val confondait forêt et village. Et les gens mouraient. Et les gens mouraient. Et le ciel restait le même.
Ce ne fut qu'au matin, après cette nuit de contemplation, que le prédicateur Marchen prit conscience de la folie dans laquelle il s'était jeté. Le village hier encore lui avait semblé pareil aux autres, à peine plus rustre et guerrier, et de pas grand chose. La maladie y avait frappé également, la maladie y était toute aussi virulente et comme ailleurs, il s'était mis à l'ouvrage, sans se rendre compte de rien. Puis ce matin, en regardant sortir ces habitants pleins d'une persévérance dont il parsemait ses discours, il n'arrivait à voir que des condamnés. Tout ce qu'il pouvait dire, tout ce qu'il avait pu penser, balayé par quelque force plus grande que lui, en une nuit, le laissait tremblant.
Mais il se remit à l'ouvrage. La fatigue, plutôt, l'aidait à impressionner, tant les cernes étaient sombres et profondes, et ses paroles empreintes d'émotion. Il allait de maison en maison, au contact des malades, et il se montrait au besoin doux ou véhément.
Partout où il allait, on lui parlait du droguiste, le docteur Dumier, à quel point on s'en méfiait, à quel point on était content que Marchen soit là.
Le prédicateur ne démentait jamais.
Le soir venu, épuisé, fin ivre, Marchen retournait à cette maison dont personne ne voulait plus, et là, entre les fleurs macérées et la tripe qu'on lui offrait, il jetait ses pensées sur le papier. Puis il regardait la page qu'il venait de couvrir d'encre, et il se prenait à rêver. Il pensait que c'était la fatigue et qu'il était passé l'heure de dormir depuis longtemps. Alors il continuait à écrire.
Puis il sortait et, dans le froid nocturne, il observait les sommets blanchis, noircis et sombres, et les derniers reflets du jour s'évanouir. Il regardait les confins d'étoiles lui apparaître, comme appelés par les premiers râles qui, un peu partout, se mettaient à s'échapper des maisons. Et les bêtes, dans le reste du val, semblaient répondre à leur tour. C'était un concert léger et diffus, désarticulé, qui durerait des heures, et des heures, et des heures. Et les gens mouraient.
Mais le ciel, lui, restait le même. Il pouvait, de son regard expert, retrouver toutes les constellations. Il s'imaginait, même, voir leur déplacement, de ce millionnième de degré dans le temps, et dos au mur contre la pierre, emmittouflé dans sa peau, il laissait dodeliner sa tête comme un chant. Ceux qui restaient dehors, comme des voleurs, et qui le voyaient là, le prenaient pour un sage et disaient qu'il était occupé à protéger le village, ou quelque sort pareil. Et Marchen regardait l'obscurité s'emplir de lumières dans l'infini de l'espace, et s'y plongeait, loin de la misère environnante.
Comment, songeait-il, ne pas se sentir insignifiant sous la voûte céleste. Comment ne pas se sentir impuissant face à la maladie, à la mort. Et, songeait-il quand il n'y prenait pas garde, si les hommes regardaient la nuit plus souvent, peut-être y aurait-il moins de maladies et de morts.
Bien sûr, après, il en riait doucement.
Ensuite, il y avait cette lanterne seule et insolente, qui continuait de papillonner à l'occasion entre les maisons, et autrement cette mélodie douce et lente, et cruelle, des râles au lointain. Mais après avoir traversé tant de villages, tant de malheurs, et conforté tant de gens, Marchen n'y prêtait plus attention.
Le matin venait. Sans savoir s'il avait fermé l'oeil, fourbi de fatigue, le corps douloureux, il quittait sa couverture avant l'aube, mangeait et reprenait son bâton. Puis, avec cette démarche pénible, il repartait voir les gens du village et leur répétait qu'il comprenait les démons. Et s'il avait tardé, s'il tardait, qu'il tarde et on viendrait le chercher, on frapperait à sa porte pour l'entendre.
Mais au matin les malades se sentaient mieux, se juraient qu'ils se remettaient, que ce jour serait le dernier. Et quand Marchen les avertissait, de sa voix terrible, qu'ils n'avaient pas fini de payer leur dû, il voyait ces guerriers baisser la tête sous son regard. On attendait qu'il dise si l'un allait se remettre ou pas, et à mesure que la journée avançait, la confiance s'étiolant, les malades devenaient défiants, lui demandaient qu'il les signe, quelque protection, et il faisait semer du sel et parlait, parlait, parlait.
À l'approche du soir, on lui parlait du droguiste, Dumier, et les villageois juraient qu'il était la cause de la maladie, et quand il les réprimandait, ils se rétractaient, disaient que le docteur n'en était qu'un suppôt. Que ses remèdes, que ses médicaments, que tout ça ne servait qu'à augmenter la douleur et rallonger le supplice, et affaiblir les volontés.
Et affaiblir les volontés.
Ce soir-là en commençant son journal, seul dans cette maison qui sentait la tripe et la macération, le prédicateur écrivit d'abord à quel point il avait peur. Il écrivait, à la lueur de la bougie, puis il sortait regarder le soir venir et les gens rentrer chez eux. Quelques-uns en le croisant lui parlèrent de bruits de griffes contre la palissade, sans qu'ils n'aient vu de bête, et lui sans y songer leur répondit que c'était un signe du démon. Il irait protéger ce côté-là. Et là-dessus, maudissant son corps endolori, il se levait, allait à la palissade répandre quelque huile au hasard.
Il voulait être revenu avant que la nuit ne le surprenne, et les pentes le ralentissaient toujours, mais enfin et en se pressant il attrapait quand même ces dernières lueurs au sommet des monts. La nuit apaisait son coeur, retirait l'angoisse qu'il ressentait secrètement, et dont il ne trouvait toujours pas la cause. Sans doute, parce que tout le village allait mourir, mais cela il ne pouvait pas le savoir. Peut-être, songeait-il aussi, parce que ce serait son tour. Et cela l'amusait, l'idée qu'il puisse prédire une telle chose, ou même quoi que ce soit.
On disait que le prédicateur affrontait la nuit. Mais il n'y avait rien à affronter. Les étoiles étaient là par milliers, par millions, par milliards, des armées infinies qui lui rappelaient les mots de ses professeurs. Le ciel tout entier était l'ennemi des hommes. Ces mêmes étoiles qui, l'instant d'après, étaient protectrices, bienfaitrices et rassurantes. Les étoiles, comme pour se justifier, dessinaient les tracés les plus complexes, les constellations. Le ciel restait le même. Et les gens mouraient.
Parce que les gens mouraient, il aurait pu croire que le ciel devenait plus sombre.
Il regardait la lanterne fugace se hasarder, aller et venir à travers les heures comme une pâle imitation de la grandeur céleste, et défier l'obscurité. À nouveau l'idée lui venait que ce pourrait être son tour, et cela l'amusait, et il trouvait dommage qu'après avoir tant professé l'existence des démons, après avoir tant annoncé voir leurs agissements, saisir leurs desseins, il ne puisse en rencontrer aucun. C'était un petit égoïsme qu'il gardait au coeur.
Vers le matin, il commençait à comprendre ce qui l'effrayait vraiment. Ce n'était pas l'impression que tout le village était condamné. C'était la manière dont tout se faisait.
Mais le seul à qui il aurait pu en parler était le droguiste, Dumier, et Marchen était trop raisonnable pour s'y risquer. Personne n'aurait voulu être vu en compagnie de Dumier, pas avec sa réputation. Alors le prédicateur se levait, prenait son bâton, retournait voir les malades dans les maisons. Commençait à broyer ses pensées secrètement.
On lui demanda d'aller à la maison du village. Le chef était alité, en train de boire le lait par gorgées. Il s'en prit au prédicateur, nia être malade et le prédicateur, sans se démonter, affirma qu'il ne payait pas pour ses crimes mais pour ceux du village. Le chef en fut satisfait. Il voulut se lever. La douleur l'en empêcha. Forcé d'être couché face à Marchen, le chef se mit à jurer que c'était Dumier qui avait empoisonné ses plats.
Marchen offrit subitement d'aller interroger Dumier, le forcer à avouer. L'instant d'après, c'était chose faite.
Il déclina les gardes, n'attendit pas et de son pas pénible gagna le gite de Dumier. Il l'y trouva en train de rédiger ses propres notes, l'interrompit. Dumier avait l'air épuisé, combatif, pareil à un animal acculé. Les premiers mots furent pour se disputer.
Ce qui surprit le plus Marchen, dans cette altercation, était à quel point Dumier ignorait combien sa situation était précaire. Le droguiste, tout occupé à lutter contre la maladie, ne pensait pas à lutter contre ses patients. Il en voulait par contre au prédicateur de vendre de fausses promesses et de piétiner la science. Et le prédicateur, en retour, de se défendre.
« Vous les guérissez, je les réconforte ! Faites votre travail, je ferai le mien ! »
Mais cette logique se frottait à la logique des habitants, et de plus en plus le prédicateur voyait Dumier comme une personne désespérée alors même que Dumier, encore rouge de colère, voyait Marchen d'un meilleur oeil, plus raisonnable peut-être que l'ensemble du village, et peut-être d'une aide quelconque. Comme une dernière branche à laquelle se raccrocher.
Quand Marchen voulut parler de la nuit, des étoiles et de ces vagues impressions sur lesquelles il n'arrivait pas à mettre d'idée précise, le droguiste perdit patience. Ils se séparèrent et le prédicateur, en sortant, s'en voulut de n'avoir pas insisté.
Dans le soir, tandis qu'il rédigeait son journal, on frappa à sa porte. Il s'arrêta. Ouvrit. Une enfant du village lui expliqua que le docteur ne serait plus un problème. L'enfant voulut guigner dans la maison mais Marchen, grandiloquent, la fit repartir encourant. Puis il retourna à son journal, voulut rajouter ce fait, s'arrêta, s'en alla faire autre chose et n'y revint qu'au dernier instant, avant de sortir se perdre dans l'infini du soir.
Aussitôt recouvert de sa peau, avec seulement sa tête exposée au vent, et tout en regardant les dernières lueurs s'échapper aux sommets des montagnes le prédicateur songea à quel point c'était chanceux qu'il n'y ait pas de nuage. Pas le moindre nuage. Pas un seul trois jours d'affilée.
Pas de pluie. Pas de grand vent. Le ciel venait se presser dans l'obscurité, faire s'élever les plaintes, les râles, et imprimer ses constellations. Marchen commençait à comprendre à quel point tout cela était simple, et parfait, et précis comme une machination. La fatigue lui faisait peindre les idées les plus folles. À nouveau il s'amusait à imaginer quelque démon véritable, loin de ses fariboles, qui se cacherait derrière la lune avec ses milliers de fils de nylon. Il avait de ces idées stupides qu'ont seulement les gens épuisés tard la nuit, comme ce qu'aurait bien pu voir un démon si un démon avait existé et avait été à sa place.
Et il se demandait s'il s'endormait vraiment, à un moment, ou si la fatigue lui cachait qu'il restait éveillé jusqu'au matin.
C'était grisant, et effrayant, ces questions sans réponse, qui pouvaient aussi bien n'être que des coïncidences dans la monotonie du monde. Mais là, dans l'obscurité, au milieu des râles qui le berçaient, Marchen se disait que c'était sa meilleure chance de vivre quelque chose de fantastique, de pareil aux légendes, ou à défaut de l'imaginer.
Bien vite, il se lassa.
Il cherchait à s'endormir, fermait les yeux, les rouvrait, s'agaçait. Il aurait voulu marcher mais l'idée de quitter la chaleur de la peau de bête, de la troquer pour le vent coupant du val, le clouait sur place. À la place, il furetait dans les ténèbres, cherchait les contours des chaumières et partout il n'y avait que l'obscurité profonde, impénétrable. Il écoutait les râles lents et longs se perdre dans de longs silences avant de reprendre, cette mélodie mêlée des cris de bêtes. Et il aurait voulu réfléchir à tout ce que cela aurait pu être, si les démons existaient vraiment, et n'étaient pas juste ces pantins qu'on lui disait de brandir pour faire plaisir au peuple, mais la fatigue l'empêchait de s'y plonger plus avant. Il voulait juste dormir, et il cherchait dans les ténèbres quelque chose qu'il ne trouvait pas.
Et les gens mouraient. Et le ciel restait le même. Parce que les gens mouraient il aurait pu croire que le ciel était plus sombre. Parce qu'il était lassé, et préoccupé, et anxieux même, il faisait en sorte de ne pas regarder le ciel étoilé cette fois.
Comme s'il aurait pu y voir quelque chose qu'il ne voulait pas voir.
Comme si la réponse à une question qu'il ne se posait pas se trouvait là.
Mais quand il leva les yeux le matin allait se lever, les étoiles disparaissaient dans la première grisaille et le froid refluait sur les pentes du val. Marchen se leva, grogna en réveillant son corps brisé, et soudain un nombre lui sauta en tête. Cent douze. Ce fut comme un frisson. Comme une révélation. Cent douze. Il ne comprenait rien mais il lui semblait tout savoir, et sans même y réfléchir, avec à peine le temps de prendre son bâton, il se força à marcher en direction de la maison de Dumier.
Il entra. Il se mit à fouiller. Il se mit à tout casser. Les habitants en passant entendirent ces rumeurs, s'approchèrent et virent le prédicateur en train de briser les fioles, de renverser les meubles avec son peu de force, et il impressionna. Plus il enrageait, plus on l'approuvait, et on se félicitait de l'avoir pour aider le village. Mais Marchen, sans même savoir ce qu'il cherchait, enrageait de ne pas le trouver et se répétait, cent douze.
Ses pas le ramenèrent chez lui, avec sous son manteau les notes du droguiste. Il ouvrit son propre journal et se mit à écrire, tout en jetant des regards rapides aux notes qu'il n'arrivait pas à comprendre, puis il se mit à dessiner, de mémoire, avec une précision infinie, le ciel étoilé. Et il avait écrit, cent douze, plusieurs fois, et il dessinait un ciel de mémoire avec une précision qu'il ne pouvait pas espérer avoir.
On frappa à sa porte, pour lui demander de venir au chevet des malades. Deux fois, il cria qu'on le laisse, refusa d'ouvrir et les gens s'inquiétèrent. Mais ensuite un guerrier vint, envoyé par le chef de village, qui frappa à grands coups et exigea du prédicateur qu'il le suive. Marchen lui ouvrit, lui intima de le laisser finir ou le chef mourrait à coup sûr avant ce soir, et il referma le battant de bois au visage de cet homme en armes. On ne le dérangea plus. Il acheva son dessin, le regarda sans comprendre, le regard fou, écrivit encore quelques mots en hâte puis, paniqué à l'idée de ce qu'il venait de faire, alla rouvrir dans l'espoir qu'il ne soit pas trop tard.
Dehors, le guerrier attendait toujours, et autour une petite foule s'était formée, anxieuse et suppliante, qui acclama le prédicateur comme un héros quand il accepta de sortir.
Il entendit, en approchant la maison du village, la femme du chef crier qu'elle allait lui apprendre, au prédicateur, à défier son mari. Ils se croisèrent. Elle allait élever la voix, se tut et le laissa passer en se contentant de murmures. Marchen avait l'air d'un fou.
Son visage était creusé au point d'en être squelettique. Son regard filait partout et, quand il s'arrêtait, rougi de fatigue, il semblait celui d'un monstre. Son corps cassé était plus saisissant encore, presque inhumain à force de courbatures et d'usure. Mais plus encore que son apparence, songea Marchen, c'était son esprit qui avait cédé. Une folie véritable, une brèche profonde qui rendait son comportement imprévisible même à lui-même. Mais il savait à présent. Il savait. Cent douze. Il pouvait tout désormais.
Le chef de village, en toussant, voulait savoir qui dans son village était coupable, voulait tuer tous les malades jusqu'au dernier. Marchen ne répondit rien. Le chef parvint à se lever, dans un élan de colère qui fit trembler le prédicateur, et deux mains meurtrières se posèrent sur deux épaules frêles. Le chef refusait de se laisser mourir sans rien faire. Il allait les tuer, tous ces démons, s'il le fallait, mais il refusait de se laisser mourir.
Dans la seconde où il se sentait réagir, où écrasé par la peur de mourir Marchen ne songeait plus qu'à fuir, dire n'importe quoi pour qu'on l'épargne, il songea que le chef avait peur aussi. Et déjà il répondait, sans plus frémir, au contraire, véhément, colérique, rageur, non, furieux même.
« Ton crime ! Nird ! Ton crime, Arcelon ! Est d'avoir voulu défier les démons ! Regarde-toi ! Regarde-toi ! »
Il avait repoussé la poigne du chef d'un geste agacé, et le chef avait reculé. Marchen ne réfléchissait plus, ne pensait plus, s'écoutait parler.
« Tu as tué tes ennemis par milliers, anéanti des armées, brisé les murs des cités, tu régnais sur les Cendres ! Mais faire la guerre aux hommes ne te suffisait pas, Arcelon ! Tu as déclaré la guerre aux démons ! Toi et ta pauvre logique humaine ! Regarde-toi, à présent, des palissades de bois et une poignée d'hommes, assiégés et impotents ! »
Le chef voulut répondre, reprendre le dessus mais Marchen le coupa net. La lame du chef était à son cou.
« Tu te bats déjà, aveugle ! Regarde ! Tous ceux qui veulent se battre tombent de malade ! La voilà, ta bataille, la dernière passe d'arme que les démons t'accordent ! Mais si tu perds, tu n'auras pas de mort glorieuse. Tu mourras seul et misérable, dans un dernier râle comme un animal ! Oh oui, c'est le prix que les démons vont te faire payer ! »
Quand on le fit enfin taire, Marchen songea qu'il était mort. Le chef hurla de le jeter dehors, et le prédicateur sans attendre s'en alla. Il entendit, dans son dos, le chef jurer qu'il allait tuer ce corbeau de malheur.
Cette menace pesa la journée entière. Mais quelque chose s'était brisé vraiment, et Marchen se moquait désormais de ce qui pouvait lui arriver. Persuadé qu'on allait le tuer de toute manière, il se montrait plus terrible et tempétueux que jamais. Aux malades, il tenait le même discours qu'au chef, et lorsqu'on lui demandait quoi faire, comment gagner, sa réponse était la même : « Rends-toi. » Et il promettait d'aider les souffrants dans leur bataille, puis les abandonnait pour la maison suivante.
Quand, au soir, il rentra chez lui, pressé de s'éloigner de tout ça, pressé de manger et de s'enfermer, il trouva des cadeaux au pas de sa porte, pain, viande, fromages, or et argent. Il regarda tout cela, hésita, décida de les ignorer et, enjambant les offrandes, referma la porte derrière. Puis il se mit à écrire, à écrire encore, avec ce même mouvement de poignet qui emportait tout le village.
Après quoi, et juste à temps, il alla s'installer et regarder s'échapper le soir.
Quand la nuit fut venue, que les râles mêlés au val vinrent le bercer, enfin Marchen sentit la tension diminuer, la crainte du lendemain s'évanouir, et il se traita de tous les noms. Il voulait s'enfuir, ne voyait pas comment, se sentait trembler et ne savait pas si c'était le froid de la nuit, tout simplement. Il se sentait ivre, pour une fois, pas du vin.
Il regarda les premières étoiles, eut du mal à les voir à travers le voile de ses yeux mais enfin resta stupéfait. Puis repoussa la couverture, courut à l'intérieur et se remit à écrire de grands mots. Il avait un nouveau nombre en tête, surgi de nulle part et dépourvu de sens, mais qui lui expliquait tout. Huitante-six.
Lorsqu'il revint s'installer, la couverture était déjà froide. Il passa vingt minutes à trembler de froid, jusqu'à s'être habitué, et il retourna à la contemplation des étoiles. D'abord ses préoccupations s'attardèrent sur le village, mais à mesure il songea à son passé, à ses écoles, aux leçons et à tout ce qu'il avait passé. Il se sentait un jouet misérable dans une farce trop grande pour lui. Et il ne croyait pas un seul mot de ce qu'il disait.
Mais à nouveau quelque chose le démangea. Une idée fugace d'abord, puis persistante, puis obstinée. Une idée absurde à force de regarder les étoiles.
Sans raison, sur un coup de tête, le prédicateur se leva à nouveau. Aussitôt le froid le gifla et il tituba jusqu'à la vieille porte, referma derrière lui en se serrant les bras. Il se mit à tousser, un peu, en fut surpris et secoua la tête. L'idée l'obnubilait à présent, pareil à un jeu d'enfant, quelque chose qu'il devait faire. Il attrapa sa bougie, ressortit et, muni de cette lumière misérable, il se mit en route. Frappa à la porte d'une maison. Exigea qu'on le laisse entrer.
Il allait passer la nuit à deux choses. La première serait de se répéter ce nombre en boucle. La seconde serait d'oublier le péril qui l'attendait. Il en venait à souhaiter de tomber malade à son tour.
La maisonnée lui obéit sans hésiter. On alluma tout ce qu'on pouvait allumer. On illumina la pièce où se trouvaient les deux malades. Puis le prédicateur s'assit à côté de la paille et se mit à murmurer des prières inventées à la volée. Il regardait ses patients aux yeux fermés, gémissant, râlant, se tordant parfois et dodelinant la tête. Il nota que l'un d'eux avait une horrible plaie au bras. On lui expliqua qu'ils avaient tenté une saignée. Bientôt, on n'osa plus le déranger.
Après une heure, ce fut peut-être son imagination, mais il lui sembla que les râles avaient diminué. Ses patients ne remuaient presque plus. Ils semblaient calmes, pour la plus grande part, tous les deux malgré leurs visages encore crispés de douleur. Cela ne signifiait rien, songea Marchen, mais il continua ses fausses prières dans la pièce illuminée. Le reste de la maisonnée regardait sans oser bouger.
Bientôt, un patient se réveilla. Il demanda à boire et Marchen fit signe. Puis le patient demanda ce qui se passait, et s'il était en train de gagner. Marchen secoua la tête. Il se fichait éperdument de ces histoires. Il regardait ce patient à moitié éveillé, qui ne râlait plus, qui affirmait se sentir mieux, au milieu de la pièce illuminée. Et il avait un horrible creux au fond de l'estomac.
Le reste de la famille se réjouissait. Mais ensuite le patient demanda à sa famille de lui apporter sa lame et son bouclier. Cela fait, il promit au prédicateur de se battre, et l'attente reprit, qui semblait interminable. Dehors les râles continuaient leur litanie lente et hasardée. Dehors le ciel restait le même.
À l'heure la plus sombre de la nuit, soudain toutes les mèches s'éteignirent.
Tout le monde autour du prédicateur s'affola. Mais Marchen continuait d'observer, dans la nuit noire, dans cette obscurité presque totale, ces deux patients condamnés. Il murmurait ses prières machinalement, sans le remarquer. Comme une protection pour lui-même. Et devant lui les râles reprirent, très vifs, horribles, dévorants. Les bougies refusaient de se rallumer. Le silex jouait en vain. Les râles s'atténuèrent, puis cessèrent totalement. quand la première lueur revint, tout était fini.
Marchen se leva, fit face à la famille et, du pied, repoussa la targe du guerrier vaincu.
« C'est une bataille perdue d'avance. »
Au matin, tout le village se racontait l'anecdote. Mais Marchen n'y prêtait plus attention. Il allait de maison en maison, se faisait répéter le récit de ce qu'il avait fait, écoutait tous et chacun promettre d'accumuler les bougies, d'emprisonner des lucioles, maintenant qu'ils pouvaient se battre. Puis un guerrier vint exiger qu'il aille voir le chef. Marchen refusa. Refusa encore. À la troisième fois, il se disputa avec la femme du chef assez fort pour le forcer, après coup, à s'asseoir, comme assommé.
Probablement qu'à ce stade Marchen ne voulait plus se battre. Chaque déplacement lui coûtait des efforts infinis. Il se traînait, et quand on le voyait arriver on venait le soutenir. On disait qu'il menait, lui aussi, un combat contre les démons, et chaque défaut de sa chair était une preuve de plus de cette lutte terrible. Et pendant toute la journée Marchen entendit autour de lui qu'avec un prédicateur pareil le village pouvait gagner.
La nuit passa à regarder les étoiles, comme une échappatoire inutile.
Le lendemain, au matin, alors qu'il récupérait son bâton pour la tournée, il vit un guerrier approcher. Il lâcha le bâton, se tint là droit. Attendit. Le guerrier s'arrêta devant lui. Puis le guerrier dit simplement : « Nird n'est plus. » Puis, après quelques secondes, Marchen hocha la tête. Et attendit. Les yeux dans les yeux du guerrier. Et ce fut tout.
Pendant la matinée encore, il fit sa tournée. À se demander quand le couperet tomberait. À se répéter, cinquante-quatre. Cinquante-quatre. Cinquante-quatre. L'impression de tout savoir, de ne rien pouvoir faire. Et plus il répétait ses mensonges, plus il commençait à y croire, lui aussi, à ces histoires de lutte et de démon.
Enfin, au milieu du jour, le nouveau chef fit rassembler le village. Plus d'une centaine d'habitants se retrouvèrent sur la grande cour, dans le replat, et Marchen se joignit à eux. C'était là moins de la moitié du village. Le tiers peut-être.
Le nouveau chef dit à la foule ce que l'ancien chef lui avait murmuré au soir.
Arcelon déposait les armes.
Tous les guerriers devaient remettre leurs armes et armures, tout le matériel de guerre. Tout ce qui pouvait être fondu serait fondu. Tout ce qui pouvait être brûlé serait brûlé. Le reste serait réduit en pièces. Il s'éleva des clameurs, de la rage, une foule en colère qui parlait de faiblesse, de lâcheté. Qui exigeait du sang. À quoi le nouveau chef intima : « Les démons ne saignent pas ! » Et avec une assurance rare, dont même Marchen ne se croyait pas capable, il réduisit les protestations au silence. Il décrivit comment l'ancien chef était mort, et le village se plia à sa volonté.
Durant toute la journée, les gens vinrent à la forge apporter leurs armes. Il y en avait tant qu'il fallut fabriquer des feux improvisés qui brûlèrent jusqu'au soir, puis après le soir, de grands feux de joie qui embrasèrent la nuit.
Et durant toute la nuit, et la nuit suivante, il y eut des râles, toujours des râles. Mais Marchen pensait, deux cent trente. Puis trois cent quarante-et-un. Et il lui semblait, mais ce n'était qu'une illusion, que le ciel était plus clair.
La troisième nuit, il n'y avait plus de râle. Les lumières étaient aux maisons. Les feux brûlaient toujours, quand bien même tout le métal avait été fondu. Les gens fêtaient alentours et ne cessaient d'inviter Marchen à se joindre à eux.
Marchen restait à l'écart, emmitoufflé dans sa peau de bête, à se demander ce qui s'était passé.
Il ne pouvait pas accepter que cela soit autre chose qu'une suite folle de coïncidences. Parce qu'il avait tout inventé. Parce que, sur autant de coups de tête, et en lisant les notes de Dumier, il avait tout créé de toutes pièces. Il avait juste voulu vivre, et tout s'était fait ensuite sans lui, comme une parfaite machination.
Si seulement un démon avait pu surgir de nulle part et lui dire ce qui s'était vraiment passé.